Chers amis,
Un toit assuré et confortable, de la nourriture en abondance, un climat ni trop chaud ni trop froid, l’absence de maladies, mais aussi de dangers extérieurs : cela ressemble à peu près à l’idée que l’on peut se faire du jardin d’Éden.
Ces conditions idéales, que la plupart des sociétés humaines recherchent, n’ont cependant rien d’évident dans la nature.
Dans les années 1960, un chercheur américain les a offertes à un petit groupe de souris.
Il a, littéralement, créé un paradis pour souris : un endroit où le gîte et le couvert leur étaient offerts, où elles n’avaient rien à craindre de températures trop basses ou trop hautes, et surtout où aucun prédateur ne pouvait pénétrer.
À votre avis, qu’est-il arrivé ?
Des souris et des hommes
Vous savez peut-être qu’un « cobaye » est d’abord… une sorte de cochon d’Inde.
Si ce terme est désormais plus connu pour son sens de « sujet d’une expérience », c’est parce que les cochons d’Inde, mais aussi et surtout les rats et les souris – bref les rongeurs – sont de longue date des « clients » de choix pour des expériences scientifiques.
Ces petits mammifères ont d’étonnants points communs avec nous, à commencer par leur patrimoine génétique : l’homme et la souris ont 99% de gènes homologues[1] !

La façon dont ces animaux se forment et grandissent, vivent et meurent, est très proche de la nôtre – mais en accéléré.
Leur métabolisme, la façon dont ils développent des cancers, des maladies génétiques, mais aussi des névroses, font des rats et des souris une sorte de version miniature (et dans une certaine mesure, simplifiée) de l’être humain.
Notre cousinage avec les rongeurs est si fort, donc, que ces animaux sont aussi bien utilisés dans des expériences génétiques et biologiques, que de sciences du comportement – car rats et souris sont, comme les hommes, des êtres sociaux.
Et c’est ce qu’a fait John B. Calhoun, chercheur américain en sciences du comportement et du cerveau : durant 20 ans il a étudié les conditions de vie « idéales » des souris… pour les rassembler toutes dans un seul « univers », qu’il a d’ailleurs baptisé Univers 25.
9 juillet 1968 : 8 souris entrent au paradis… vivantes !
Un an avant que l’Homme ne pose le pied sur la Lune, un Américain fait donc poser à 8 souris blanches la patte au paradis.
Ces 8 souris blanches (4 mâles et 4 femelles) ont été triées sur le volet : elles sont en parfaite santé, en pleine forme.
Leur paradis prend la forme d’un enclos à ciel ouvert d’1,37 m sur 2,57 m, où tout est fait pour qu’elles se la coulent douce, et n’aient à se soucier de rien : eau et nourriture à volonté, climat contrôlé, absence de prédateur, etc.
Durant tout le cours de l’expérience des précautions seront prises pour éviter tout risque qu’elles développent des maladies, comme le nettoyage régulier des fèces.
L’objectif est d’abord d’éviter à ces souris ces « fléaux » mortels que sont :
- La famine
- La déshydratation
- La prédation
- La maladie.
John B. Calhoun raconte lui-même le déroulement et l’issue de cette expérience « paradisiaque » dans un compte-rendu publié en janvier 1973 dans Proceedings of the Royal Society of Medicine[2].
Le voici en février 1970 au milieu de son « paradis », 681 jours après le début de l’expérience :

Au début, tout n’est que luxe, calme et natalité
Les 4 « paires » d’Adam et Eve à poils blancs ont effectivement vécu au paradis : elles ont prospéré.
Elles ont passé les premières dizaines de jours à se partager leur territoire, et à construire des nids.
Au début, la population double tous les deux mois : la population s’élève ainsi, au fil des portées successives à 20, 40, 80, 160, 320 puis 620 souris un an plus tard.
Tout ce petit monde cohabite à merveille et les souris les plus anciennes mourront de leur belle mort, âgées de 800 jours – l’équivalent de 80 ans chez les humains.
Entretemps, la croissance de la population a ralenti. 560 jours après le début de l’expérience, le paradis des souris atteint son « pic » démographique, qui s’élève à 2200 habitants.
Et à partir de ce moment-là… l’utopie commence à sentir le soufre. Le paradis se mue en enfer.
Lutte des classes à poils ras
Univers 25 est une expérience autant biologique que sociale.
Une fois la population maximale atteint, les souriceaux ne survivent plus. La toute dernière naissance a eu lieu le 920ème jour.
Entretemps, les souris se sont « organisées » : des groupes se sont d’abord formés, 14 en tout.
Ces groupes ont une natalité très différente : le « premier » groupe a engendré 111 petits, et le dernier, seulement 13.
Ce chiffre n’est pas le fruit du hasard : chacun de ces groupes est dirigé par un mâle dominant. Le mâle le plus dominant est celui qui fait le plus de petits.
Mais à la fin de l’expérience… plus aucun mâle ne faisait de petit. Et plus aucune femelle non plus évidemment.
Que faisaient-ils ?
Ils se sont là encore répartis en « classes sociales »… stériles.
Il restait une classe de mâles dominants : ces mâles passaient leur temps à manger et à se battre. La lutte et l’agressivité était leur moyen d’assurer leur suprématie sur les autres groupes.
La classe de mâles « dominés » grossit à mesure que la population augmentait et que les plus jeunes ne parvenaient pas à s’imposer : ces mâles dominés se rassemblaient en larges groupes au centre de l’espace (ils n’avaient donc plus de territoire à eux, et ne pouvaient « émigrer » ailleurs) et devinrent inactifs.
Ces mâles dominés, note John B. Calhoon, bien que dépourvus d’activité et d’agressivité, portaient néanmoins de nombreuses blessures car ils faisaient régulièrement l’objet d’attaques des mâles dominants. Certaines de ces souris dominées devinrent cependant à leur tour des souris agressives, reproduisant le schéma d’agression.
Le comportement des femelles changea lui aussi peu à peu.
Les femelles qui avaient des petits, ne pouvant plus compter sur la défense de leur territoire par les mâles, devinrent elles aussi agressives… Les souriceaux pâtissaient également de cette agressivité généralisée : les mères changèrent de plus en plus fréquemment de nid, abandonnant parfois leurs petits au passage.
C’est durant cette phase que la natalité commença à s’effondrer : le comportement sexuel des souris était perturbé, les portées n’arrivaient pas à terme, et les souriceaux qui naissaient ne survivaient pas longtemps.
La fin
Au bout de deux ans et demi d’expérience, la population pléthorique d’Univers 25 était donc déclinante : la colonie était composée exclusivement de souris adultes et vieillissantes.
À cette étape de l’expérience, les souris les plus jeunes ont été prématurément « éjectées » de leur nid : John B. Calhoun estime qu’elles n’ont eu le temps de développer ni de liens affectifs matures, ni de relations sociales adéquates.
Ces jeunes souris devinrent des adultes formant elles-mêmes des classes à part :
Une classe de femelles « célibataires » s’établit dans des petits espaces situés sur les parois d’Univers 25 : là, elles ne souffraient pas de l’agressivité de la masse, et passaient leur temps à manger et à dormir, sans avoir aucune interaction avec des mâles.
Chez les mâles, qui trouvaient de moins en moins de partenaires sexuels et étaient de plus en plus engagés dans des combats incessants, on vit émerger une nouvelle classe, que John B. Calhoon appelle « the beautiful ones », soit « les mignons ».
Ces mâles ne cherchaient jamais à approcher des femelles, ne participaient à aucune bagarre et ne portaient donc pas de blessure. Leur pelage était par conséquent soyeux… et ils passaient le plus clair de leur temps à se toiletter, en plus de manger, boire et dormir.
Là où l’expérience prend une tournure encore plus sombre, c’est dans le scénario de son déclin définitif.
Peu à peu, les souris qui vivaient dans l’agressivité constante moururent soit de vieillesse, soit après s’être entre-dévorées : les femelles « célibataires » et les mâles « mignons » devinrent majoritaires.
À ce moment-là, la population avait largement décru, et ces souris étaient encore en âge de procréer.
Mais ils ne le firent pas : les femelles restèrent isolées, et les mâles continuèrent à se toiletter.
Les derniers mâles moururent 1780 jours après le début de l’expérience, sans avoir jamais cherché à obtenir les faveurs d’une femelle.
Les seules « survivantes » de l’expérience furent ces femelles retranchées dans leur tour d’ivoire : à la fin de l’expérience, on les « relogea » en compagnie de colonies de souris normales. Mais jamais elles n’eurent un comportement de souris normale : elles se contentèrent de manger et de dormir, sans jamais côtoyer les autres souris, ni procréer.
Extinction totale
L’aspect glaçant de cette expérience ne tient pas tant à la croissance rapide puis au déclin radical de la colonie, qu’au fait suivant : les derniers membres de la colonie avaient biologiquement les moyens de faire « repartir » la population, mais n’en avaient plus les moyens sociaux et psychologiques.
La logique pure voudrait en effet que, la crise démographique passée, les survivants les plus jeunes s’accouplent à leur tour et permettent à la colonie d’être, en quelque sorte, fondée sur de nouvelles bases.
Mais ce n’est pas ce qui s’est passé au cours de cette expérience. La crise n’était pas seulement démographique : elle était également psychologique, et sociale.
Cette expérience fascinante fait froid dans le dos.
Plusieurs commentateurs, depuis, y vont vu une forme de prémonition de l’effondrement qui attend notre civilisation, confrontée à un vieillissement problématique (en Occident), et à une pression démographique de plus en plus lourde (partout).
D’autres, au contraire, arguent que l’homme n’est pas une souris, et que la société humaine ne peut « s’auto-détruire » de la sorte : l’humanité est plus intelligente que cela, et ne saurait subir le même sort qu’une colonie de rongeurs.
Mon opinion est… que les deux points de vue se valent (rappelez-vous que je suis Normand).
Je m’explique.
Dans la conclusion de son article, John B. Calhoun dit avoir voulu étudier ce qui se passe pour un groupe social qui n’est pas confronté aux causes habituelles de mort que l’on trouve dans la nature : c’est-à-dire la mort par privation de nourriture, par attaque d’un prédateur, par stress environnemental ou encore par maladie.
Toutes ces souris étaient en effet protégées de ces dangers.
Elles sont mortes, individuellement, de vieillesse ou dans des luttes intestines.
Et elles sont mortes, collectivement, par le « désapprentissage » de ce qui avait d’abord fait la prospérité du groupe.
Les premières générations – celles de la croissance – ont été confrontées à une pression démographique qui s’est traduit par un dérèglement social : les hiérarchies familiales qui ont d’abord permis à la colonie de grandir, ont laissé place à des jeux de pouvoir agressifs et égoïstes.
Les générations suivantes ont, elles, désappris les codes culturels qui permettaient aux groupes de se renouveler : les parades nuptiales, les soins maternels, la défense du territoire.
Nous pouvons, en tant qu’êtres humains, nous croire supérieurs aux souris. Mais le fait est que nous sommes également des êtres sociaux, dont la survie individuelle est conditionnée par l’équilibre des liens que nous entretenons avec les autres.
Ainsi, nos « codes culturels », bien que plus complexes que ceux des souris, reposent en partie sur les mêmes bases : l’importance du territoire, la qualité de nos liens sociaux, la puissance de nos liens affectifs, les soins que nous portons à nos petits, leur éducation.
Ne pas le reconnaître serait absurde. Et la seule chose qui nous distingue réellement de ces pauvres souris, et qui peut nous sauver… serait l’intelligence de reconnaître que nous ne sommes pas différents d’elles, pour ne pas faire les mêmes erreurs.
Je vous laisse méditer là-dessus, et vous souhaite un bon dimanche.
Rodolphe
Sources :
[1] Dr. Olivier Namy Futura-Sciences UK, « Du génome de la souris à celui de l’homme », décembre 2002 https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/genetique-genome-souris-celui-homme-1439/
[2] Calhoun JB. Death squared: the explosive growth and demise of a mouse population. Proc R Soc Med. 1973;66(1 Pt 2):80-88, consultable sur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644264/pdf/procrsmed00338-0007.pdf
Les lecteurs lisent aussi...
Les choses qui font battre mon cœur
La taille des choses
Guérison et spiritualité
Répondre à Pascal Annuler la réponse
En soumettant mon commentaire, je reconnais avoir connaissance du fait que Total Santé SA pourra l’utiliser à des fins commerciales et l’accepte expressément.

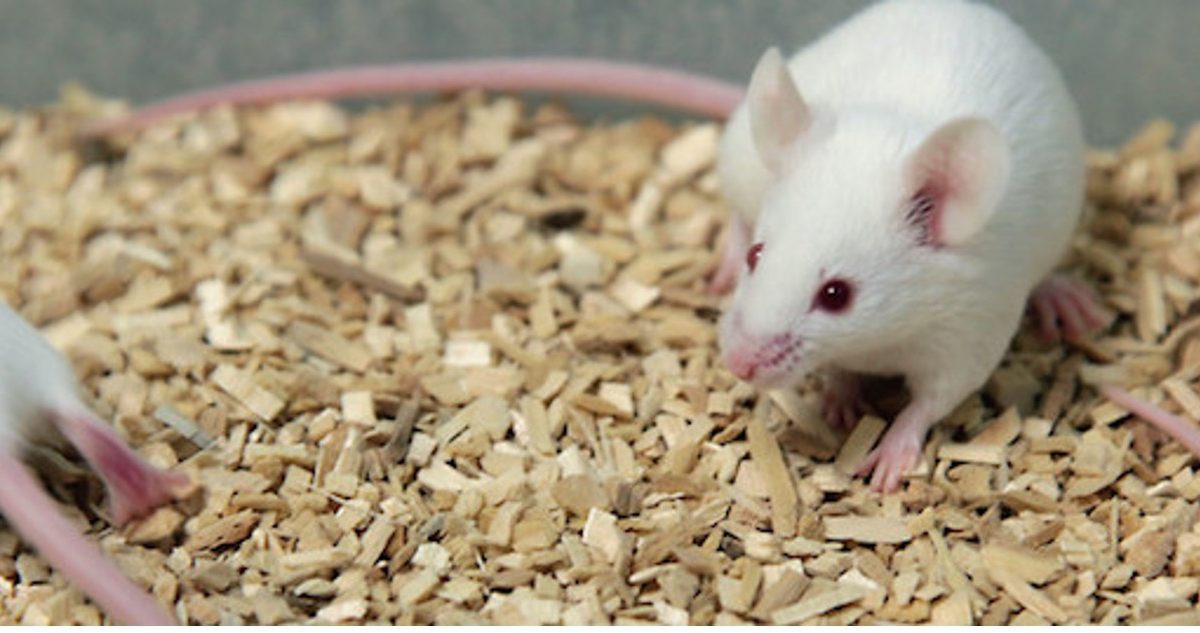


Vos conclusions sont hâtives, nous vous conseillons de vous pencher sur le principe de transition démographique, d’ une part . Et sur d’autres expériences faites sur le même animal et les addictions. Vous verrez que lorsque l’ on vit dans ce que vous définissez comme » le faux paradis » et que d’autres nomment une société équitable l’ enfer ce ne sont pas les autres, mais nous même dès que nous voyons le mal chez les autres et que nous perdons confiance en l’autre et en particulier dans les scientifiques.
Nous y sommes. Avec la gestion de la crise de la Covid, nous entrons dan s la phase de « désocialisation ». Gestes barrières, masques nous font perdre le lien avec nos proches et les autres. la seule question est de savoir combien de temps il nous reste avant la fin de l’humanité. Bien que à mon avis il restera une caste qui à l’heure actuelle ne subit pas la pression « Covid ».
Bien à vous
@Patrick :
A la question « que va-t-il arriver à notre espèce (ainsi qu’à la biosphère) de pénible dans un avenir relativement proche ? »,…. je préfère : « que pouvons- ou devons-nous faire, pour éviter un futur plus que probablement problématique causé par l’égocentrisme, l’irrationnalité et, surtout, l’ignorance humaine ? »
Cordialement
alessandro pendesini
Je pense que ces souris n’ont pas connu le paradis mais l’enfer, vivre dans une cage dorée reste vivre en cage sans même le choix de cette cage et le lieu où placer cette cage! Le paradis sans la liberté c’est quand même oublier l’essentiel.
Franchement, envoyer un message de cette noirceur un dimanche…